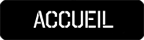








Avant de nous envoyer toute participation, veillez à avoir bien consulté notre protocole de rédaction ; la rédaction s’autorise à rejeter tout travail ne respectant pas les normes requises.
Appel à contribution pour le numéro 25 de la revue Proteus : Centenaire Robert Filliou, né le 17 janvier 1926 à Sauve (Cévennes, Gard, France), s’il vous plaît lancez des Bombes de la Paix
Date et conditions de soumission des argumentaires : les propositions d’article (environ 3000 signes, plus une courte bio-bibliographie) sont à envoyer avant le 2 mars 2026 à l’adresse de la revue en format éditable de préférence (odt, docx, rtf, etc.) : contact@revue-proteus.com – les notifications d’acceptation ou de refus seront transmises mi-mars.
Date et conditions de soumission des articles : une fois l’argumentaire retenu, les articles (entre 25000 et 45000 caractères) sont à envoyer à la même adresse que les argumentaires de préférence avant le 22 juin 2026.
Coordination du dossier : Emma Gazano et Cécile Mahiou
Le nom de cet homme n’est pas important.
Il est mort, mais l’art est vivant.
Pas besoin de noms dans cette histoire1.
Le 17 janvier 1926 naissait Robert Filliou, voilà bientôt cent ans.
Au-delà de la célébration d’une œuvre, cet Anniversaire de l’art si particulier est l’opportunité d’établir de nouvelles généalogies critiques, sans chercher l’inédit ou forcer des liens, mais plutôt en tâchant de lire le plasticien, poète et philosophe, en portant à conséquence son grand travail de circulation théorique, disciplinaire, spirituelle, entre les champs et entre l’art et la vie.
Plutôt que ce qu’il reste – les traces d’une pertinence par devers les temps et contextes rendant possible une panthéonisation – il s'agirait plutôt de venir faire le relevé de ce qui était en germe – non pas préfiguré, à la façon d'un oracle, mais porté, charrié, par ce que fut Robert Filliou ; en toute cohérence avec sa définition d’une temporalité enchevêtrée : à la fois simultanée lorsqu’elle concerne la création artistique, à rebours quand elle touche à l’intuition, sans mort et donc sans but.
Si l’œuvre de Robert Filliou est aujourd’hui relativement peu connue et commentée, on la croise cependant régulièrement dans les musées d’art contemporain, et son œuvre écrite a fait l’objet de rééditions récentes, qui contribuent à lui donner accès. Depuis une quinzaine d’années, elle fait aussi l’objet d’ouvrages critiques et de travaux académiques en esthétique et théories de l’art, en histoire de l’art, en littérature ou en philosophie, tout en étant une référence fréquente et incontournable pour de nombreux artistes, écrivain·es et poètes contemporain·es.
La quête d’une homologie de notre fête et de son esprit ne doit pas rabattre la réflexion théorique à un exercice d’admiration ; certes, tout ceci est un travail d’amour, mais, puisqu’il n’y a plus de centre, il ne faut pas ériger une statue, organiser un fan club pour Happy Few. En proposant ce numéro, il s’agit de perpétuer et diffuser l’esprit Filliou, cet esprit comme Personne Éternelle, qui se passe de noms, voire de conscience ; qui s’infiltre, qui traverse les corps et les moments. Dès lors, puisque Filliou a voulu et su s’effacer derrière son poème en le devenant, l’on pourrait ouvrir la réception à une postérité qui ne se revendique pas de cette figure, mais qui, de fait, est concernée par les enjeux d’une œuvre polymorphe et programmatique. Le caractère intermédiaire et intermédiatique de la pratique créative, au cœur de la pensée du poète, son objectif crucial de dissolution, de « dernier adieu », trouve aujourd’hui son prolongement dans des formes, des gestes et des pratiques qui semblent une actualisation des plus pertinentes de ses préoccupations. Si « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », qu’il est ce qui permet d’investir le quotidien, qu’en est-il aujourd’hui du statut de l’œuvre ?
Peut-être pourrions-nous alors remplacer « intéressant » par « urgent » dans la célèbre phrase de Filliou en posant cette question : si l’art est ce qui rend la vie plus urgente que l’art, où en est-on aujourd’hui de sa dissolution dans cette dernière ?
Dans un des derniers textes avant sa mort, Filliou travaille à la Biennale de l’Art de la Paix, qui devait se tenir en août 1989 à Amsterdam. Il propose de « préparer la paix, intérieurement et extérieurement », puisqu’« [elle] est un art ». On se souvient aussi de son projet COMMEMOR (1967-1970), pour « Commission Mixte d’Échange de Monuments aux Morts, qui proposait aux gouvernements européens « pour sceller définitivement la réconciliation […] d’échanger leurs monuments aux morts respectifs ».
Cet appel à célébrer son centenaire est aussi celui à fabriquer de nouvelles « Bombes de la Paix2 », penser et mettre en œuvre des formes de l’agir créatif, comme autant d’hommages que de moyens d’accélérer la fin de l’art. Sous quelles formes singulières ces « bombes » que le poète appelait de ses vœux pour « chasser les nuages de la catastrophe » s’incarnent-elles aujourd’hui ?
Axes possibles
- Pédagogies alternatives ; libération, émancipation par l’éducation ; Enseigner et apprendre comme manuel
- Écologie politique ; rapport au quotidien, care, compagnonnages, Eternal Network/ Réseau éternel, y compris dans une perspective féministe ou écoféministe.
- Économie poétique (travail/loisir) ; valeurs de l’art
- Pratiques collectives, participation, publics de l’art
- Dispositifs et pratiques d’écritures ordinaires dans l’art et la poésie contemporain·es
- Médiatisations et patrimonialisation de l’œuvre de RF (archives, conservation, diffusion)
1. Robert Filliou, L’Histoire chuchotée de l’art, traduction (anglais) Anne-Marie Hui Bon Hoa, repris dans le catalogue L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art, dirigé par Richard Martel, Québec, Les Éditions Intervention, 2003, p. 39.↩︎
2. En citant le Livre de la Paix de Bernard Benson, dans la lettre à Louwrien Wijers à propos de la préparation de Art of Peace Biennale 2 .↩︎
La revue Proteus est une revue universitaire francophone d’esthétique. En tant que telle, elle ouvre ses colonnes à toute contribution scientifique de qualité en langue française traitant de problématiques rattachées au vaste domaine des arts. Il est donc attendu des auteurs qu’ils déploient un appareil critique à même de faire valoir la respectabilité d’une réflexion personnelle.
Chaque numéro présente un dossier correspondant à l’appel à textes qui lui a précédé, ainsi que divers articles hors thème. Tous ces articles, d’une longueur comprise entre 20 000 et 30 000 signes, devront être introduits par un abstract de 600 à 800 signes et, si faire se peut, sa traduction en langue anglaise. Les propositions d’articles sur le thème annoncé devront préférablement être annoncées par un argumentaire d’environ 3000 signes avant la date indiquée dans l’appel.
Afin de préserver l’impartialité du comité de rédaction, les articles proposés ne devront contenir aucune information révélant l’identité du ou des auteurs : ces informations, accompagnées d’une succincte notice biographique, doivent en revanche figurer dans l’e-mail transmettant le document à l’adresse contact@revue-proteus.com
Outre des travaux de recherche inédits, la revue se propose de publier des traductions originales d’articles et autres publications jusqu’ici indisponibles en français. De même que les articles hors thèmes, ces contributions n’ont pas à se plier au calendrier des appels.
Toute proposition doit se présenter dans un document au format *.rtf, *.doc ou *.odt, avec notes en bas de page et références complètes, mis en forme selon les normes universitaires. Ces normes sont consultables à cette adresse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour le télécharger dans un format éditable (odt).
Le comité de rédaction se réserve le droit de rejeter toute proposition ne correspondant pas à ces critères.
Chaque numéro de la revue, édité en *.pdf, nous permettra d’apprécier le travail d’un de nos collègues plasticiens. Chacun est libre de toute contrainte de temps pour nous proposer illustrations ou mises en pages élaborées sur le thème des appels en cours. Ces travaux, nécessairement libres de droits, doivent correspondre au format A5, soit une résolution minimale de 1772*2480 pixels pour 300 dpi.
Le site de la revue publie également en marge de celle-ci des recensions de parutions récentes en esthétique et sciences humaines. Tout travail de ce type peut être soumis à notre comité de rédaction en vue d’une publication. Des textes critiques de 4000 à 6000 signes, au format *.rtf, *.doc ou *.odt sont attendus.
Si vous désirez participer à la sélection des articles, leur révision et toutes ces autres expériences qui constituent l’aventure fabuleuse de la publication de travaux de recherche en sciences de l’art, n’hésitez pas à nous contacter