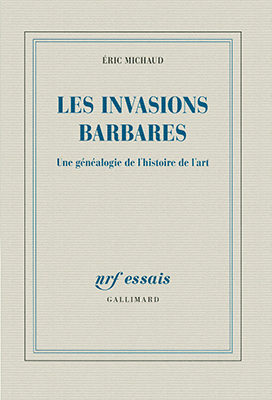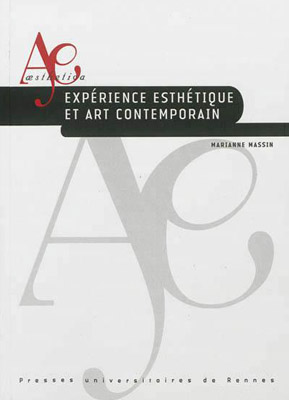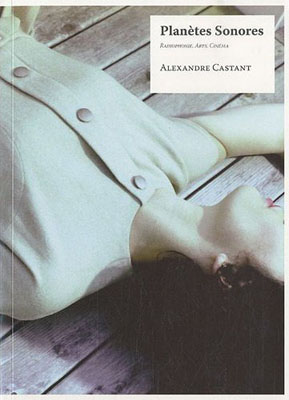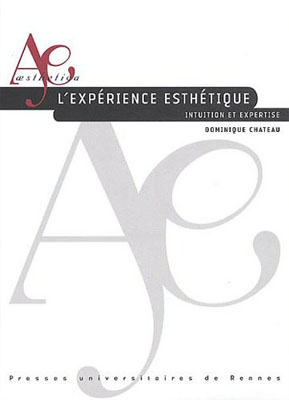Recensions d’ouvrages scientifiques
Proteus vous invite à lire :
- Danièle Méaux : Enquêtes. Nouvelles formes de photographie documentaire, Paris, Filigranes, 2019
- Jacinto LAGEIRA : L’Art comme Histoire. Un entrelacement de poétiques, Paris, Mimésis, 2016
- Éric MICHAUD : Les Invasions barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art, Paris, Gallimard, 2015
- Aline CAILLET : Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014
- Marianne MASSIN : Expérience esthétique et art contemporain, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013
- Alexandre CASTANT : Planètes Sonores. Radiophonie-Arts-Cinéma, Nouvelle édition revue et augmentée, Blou, Monografik Éditions, 2010
- Dominique CHATEAU : L’expérience esthétique — Intuition et expertise, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010
Enquêtes. Nouvelles formes de photographie documentaire de Danièle Méaux
Au XIXe siècle, l’image photographique était considérée comme un outil scientifique ; elle a été abondamment utilisée pour ses qualités objectives et documentaires par les sociologues, les archéologues, les géographes ou les criminologues… Aujourd’hui ces qualités sont largement mises en doute, tant par les scientifiques que par les photographes. Pour autant, la collaboration historique des sciences humaines et de la photographie n’a cessé de croître et elle se manifeste aujourd’hui au sein de pratiques artistiques où les photographes s’inspirent de méthodes de travail empruntées aux sciences humaines, tout en les problématisant et les questionnant. C’est à ces pratiques que Danièle Méaux consacre son ouvrage Enquêtes. Nouvelles formes de photographie documentaire au sein duquel elle convoque le travail des photographes contemporains qui procèdent à partir de la mise en œuvre d’une enquête. L’ouvrage est une source précieuse, par le nombre important des œuvres qu’il convoque.
Organisé en neuf chapitres, le livre détaille les différents types d’investigations menées qui entrent en résonance avec les domaines de la géographie, de l’urbanisme, de l’archéologie, de la criminologie, de la sociologie ou encore du journalisme. Certains de ces échos organisent en creux la répartition des chapitres. Mais ce qui est envisagé de manière plus frontale, c’est la façon dont les photographes contemporains mènent l’enquête : investigations visuelles, protocoles, dispositifs, collaborations avec des chercheurs en sciences humaines, reprise et fouille d’archives existantes, constitution d’archives consultables et modifiables sur le web, ou encore entretien dirigé. L’ensemble de ces mises en œuvre active le processus photographique, mais il a aussi un impact sur la présentation du travail, qui, du support livre à la cimaise, adopte la forme du dispositif afin de relancer l’attention portée au réel. Il ne s’agit plus pour les photographes de représenter une réalité mais, comme l’écrit Danièle Méaux, de passer « d’une logique de la représentation (à la forme plus ou moins concertée) à une logique de l’enquête, sise sur une expertise du terrain et chevillée sur des manières de faire ». Le travail de terrain engage l’expérience dynamique du photographe, qui propose alors au spectateur une lecture croisée de ses images – les liens signifiants entre les données rassemblées (visuelles, textuelles, cartographiques) étant proposés à son exploration. L’ouvrage étudie des pratiques photographiques variées dont les procédures, les objectifs, les intentions diffèrent.
Des expériences menées sur le paysage, on retiendra l’ambition d’analyser les usages d’espaces spécifiques (GR périurbains, terrains vagues ou zones bordant une ligne SNCF) et l’emploi de méthodes d’enquête variées. Un territoire est le fruit de réseaux architecturaux, logistiques et humains et les restitutions photographiques analysées tiennent compte de ces interactions invisibles et les explorent par le biais de protocoles ou de dispositifs singuliers susceptibles de les questionner. Mais, comme le rappelle justement Danièle Méaux, la restitution tend à garder ses distances par rapport à un formalisme trop appuyé, puisque le référent ne doit pas être réifié ou esthétisé par les images, en particulier lorsqu’il s’agit de ruines industrielles ou architecturales.
Grâce à l’enquête menée dans les fonds d’archives, le lecteur / spectateur, passant d’un document (visuel ou textuel) à l’autre, actualise – dans le moment de sa consultation – des situations humaines et sociales établies historiquement. L’entreprise initiée par le photographe lui permet de rendre visible des faits historiques jusque-là occultés par la mémoire collective. En reprenant le terme d’Enzo Traverso, on pourrait avancer que Mathieu Pernot, Catherine Poncin, ou Camilo José Vergara luttent contre la « mémoire faible » qui entoure l’histoire de la condition ouvrière, celle de la déportation des bohémiens sous le régime de Vichy ou encore celle des ghettos urbains étasuniens.
L’ouvrage se clôt par trois chapitres consacrés à l’enquête policière, qui, des physionomies criminelles d’Alphonse Bertillon, aux photographies de Rodolphe Archibald Reiss, privilégie le portrait et la scène de crime comme théâtre d’investigation. Reprenant ces méthodes, le collectif russe AES+F et Stéphanie Solinas mettent en doute la pertinence du dispositif identitaire de la photographie, tandis que Cédric Delsaux, Tacita Dean, ou John Sternfeld interrogent des espaces tant géographiques que mentaux (pour Tacita Dean) où le crime a eu lieu ou s’est fomenté.
La distribution des neuf chapitres met en évidence la diversité des emprunts fait aux méthodes de recherche des sciences humaines effectués par les photographes contemporains. Le rapprochement de cet ensemble de pratiques d’enquête met en lumière la volonté des artistes d’interroger le réel et de produire ou de faire ressurgir des documents visuels susceptibles d’activer ou de réactiver des réalités invisibles car sises dans les relations entre les éléments, plutôt que dans les apparences des objets. Ainsi l’expérience dynamique du photographe et du spectateur sont-elles mobilisées.
Sandrine Ferret
L’Art comme Histoire. Un entrelacement de poétiques de Jacinto Lageira
Quelles perspectives critiques nouvelles sur notre Histoire collective peuvent proposer des œuvres qui mélangent documents d’archives et compositions fictives ? Pourquoi l’artiste qui choisit d’articuler ces deux processus, archivistique et fictionnel, doit veiller à ne pas créer d’assimilations abjectes ? Comment faire jouer ensemble attestation de faits et construction de fictions sans prendre le risque de mésuser des matériaux testimoniaux cités dans une œuvre ? Comme L’Art comme Histoire le formule avec vigueur, les écritures alternatives de l’histoire que l’interpolation de documents « authentiques » dans un dispositif artistique permet se développeront d’autant mieux qu’un certain préjudice porté à la réalité à laquelle ces documents réfèrent — à diagnostiquer au cas par cas dans les œuvres — sera évité. Selon Jacinto Lageira, lorsqu’un artiste intègre des éléments documentaires à son œuvre, la visée référentielle — ou réaliste — du matériau utilisé ne saurait être totalement occultée. En ce qu’il manie des éléments attestant d’une réalité, l’artiste a une responsabilité morale qu’il n’a pas — ou qui n’est pas du même type — en tant qu’il œuvre uniquement dans la fiction et à partir d’éléments qui ne font pas office de preuve. Mais comment faire place à un engagement réaliste dans le cadre d’une démarche qui est essentiellement artistique, et non pas historienne ?
Bien entendu, il ne s’agit pas de disqualifier le mélange de la fiction et du documentaire dans une œuvre. Loin de s’ériger en censeur des pratiques explorant de nouveaux usages artistiques de l’archive, l’auteur entend au contraire défendre l’interpénétration des élaborations fictionnelles et des procédures enquêtrices en art. Mais, pour mieux asseoir la légitimité de ces recherches historiennes en art, il s’agit de contester l’absorption des traces factuelles dans une trame fictionnelle qui ferait disparaître complètement leur statut d’origine. Très marqué par diverses dérives des pensées du simulacre, Lageira rappelle fréquemment que certaines options théoriques ont abouti à un « négationnisme de la réalité ». Dans un de ses ouvrages précédents (La déréalisation du monde, Paris, Jacqueline Chambon, 2010), étaient ainsi mentionnées et commentées la phrase de Jean Baudrillard de 1991, « La guerre du Golf n’a pas eu lieu », et la déclaration de Karlheinz Stockhausen suite aux attentats du 11 septembre, « Ce à quoi nous avons assisté [...] est la plus grande œuvre d’art jamais réalisée ». Dans L’Art comme Histoire, Lageira s’attaque davantage à ce qu’il considère comme des dérives de certaines options artistiques relevant notamment du « style documentaire ».
Il arrive qu’une œuvre fasse perdre à des éléments visuels ou sonores documentant une réalité leur capacité de référer à ces faits réels. Ne parvenant plus à s’orienter vers leur but, les rayons de la visée référentielle s’éteignent. Le champ magnétique de la fiction attire tout à lui, et plonge dans le noir le pôle du factuel. L’« esthétisation » condamnée par Lageira réside dans cet excès de fictionnalisation qui nous fait courir le risque de glisser vers un monde de purs simulacres déréalisants, où les événements tragiques et traumatiques d’un passé lointain ou récent sont oubliés, occultés, déniés (en particulier, les crimes de masse et les actes de tortures, souvent évoqués par l’auteur). Compromettant les chances de faire advenir les témoignages, la reconnaissance des faits et le travail de mémoire, cette esthétisation aboutit à « un déni de réalité, une fuite devant la responsabilité qui tisse les liens sociaux et nous engage à l’égard d’autrui » (p. 90).
Dès lors que l’artiste compose son œuvre avec des éléments documentaires, comment considérer l’empiètement qu’il opère dans un champ qui n’est pas le sien à l’origine : le champ d’investigation des historiens ? Dans les deux premiers chapitres de son livre, Lageira s’appuie sur plusieurs pensées permettant de conceptualiser de façon adéquate la différence ontologique entre pratique historienne (« poétique de l’Histoire ») et pratique artistique (« poétique de l’Art »). Il distingue de façon précise et convaincante ces deux champs disciplinaires. La visée fictionnelle prévaut en art — la poétique de l’art repose sur « un système autoréférentiel agencé d’après des marqueurs de fictionnalité », explique-t-il —, tandis que c’est incontestablement la visée réaliste qui a la précellence en histoire. C’est pourquoi la poétique de l’histoire comporte et exige « un système de référentialité externe avec ses marqueurs de véridicité adéquats ». Lageira souligne la pertinence de la définition de Paul Veyne : « L’histoire est un roman vrai ». En effet, les historiens sont ceux qui mettent en récit tout en cherchant à dire le vrai. C’est en cela que le travail imaginatif de l’historien n’aboutit pas, au premier chef, à une œuvre fictionnelle. Relevant d’une mise en intrigue littéraire sans être de l’art et relevant d’une production de scientificité sans être une science, le récit de l’historien n’a de valeur qu’en tant qu’il est consistant dans sa vraisemblance et crédible relativement aux procédures de vérifications auxquelles il ouvre. En fin de compte, comme le montre parfaitement Lageira, c’est la pensée d’Aristote qui, d’emblée, pose bien la différence des deux poétiques : la mimésis des arts traite du vraisemblable alors que l’histoire traite du vrai. Élaborer un récit historique vraisemblable n’est, pour un historien, qu’un moyen de se rapprocher du vrai. Inversement, intégrer à l’œuvre des documents vrais n’est, pour un artiste, qu’un moyen — parmi d’autres — d’élaborer du vraisemblable. C’est pourquoi « l’expérience imaginative de l’histoire est assurément très différente de l’expérience imaginative de l’art » (p. 64).
Si la prise en charge historienne d’un artiste qui s’engage dans la voie du style documentaire est défaillante, son œuvre est alors irrespectueuse d’une factualité qui ne saurait être mise à mal sans s’accompagner, de façon volontaire ou involontaire, d’une caution accordée à une amnésie collective. À bien des égards, il est donc décisif de pouvoir déceler la présence du document dans l’œuvre, grâce à des « marqueurs de documentarité » (p. 24). C’est pourquoi Lageira s’insurge contre la disparition de la visée référentielle que l’on peut diagnostiquer dans certaines œuvres composées de documents historiques. La vocation première du matériau documentaire est de référer à la réalité. Portant sur des œuvres mi-fictionnelle mi-documentaire — étant entendu qu’aucune œuvre n’est jamais une « pure fiction » ou un « pur documentaire » —, L’Art comme Histoire interroge les modalités de rapport au réel impliquées dans des pratiques faisant intervenir conjointement deux processus : une poétique artistique et une poétique historienne. Même si les deux poétiques sont toujours mélangées en fait, il n’en reste pas moins qu’elles sont à distinguer en droit. Comme cet ouvrage le met en évidence, il est décisif de pouvoir se rapporter à la distinction de droit afin d’être en mesure de départager les bons et les mauvais mélanges de fait.
« L’indiscernabilité est ce que recherchent parfois certains artistes se faufilant dangereusement entre les frontières de la visée réaliste et de la visée fictionnelle. » (p. 23) Effectivement, Lageira a raison d’y insister, cette position qui aboutit à une indiscernabilité complète est intenable. Mais cette confusion suppose-t-elle simplement un brouillage de la zone séparant la réalité de la fiction ? Car, somme toute, au-delà d’une frontière — si « brouillé » soit cet espace frontalier —, les territoires s’étendent de façon autonome. Il est à supposer alors que le champ fictionnel et le champ documentaire ne se mélangent plus dans les contrées extra-frontalières. C’est pourquoi, à l’égard de certains aspects des rapports entre réel et imaginaire, la notion d’entrelacement s’avère sans doute plus pertinente que celle de frontière, qui prévaut, quant à elle, dans le dernier ouvrage de Françoise Lavocat (Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016), au demeurant très riche. Indéfectiblement, le brouillage est ce qui nous confronte à une impuissance à dénouer, à discerner et à trier. L’entrelacement, en revanche, laisse possible le démêlage des fils — si tant est que le spectateur s’empare de cette possibilité —, afin de remonter aux deux pelotes dont ils proviennent : réalité et fiction. Autrement dit, il devrait toujours être possible d’apercevoir les « horizons » vers lesquels tendent les diverses entités entremêlées ou entrelacées. C’est ce qui se produit par exemple dans plusieurs œuvres de Walid Raad lorsque la principale caractéristique du document y est « de véhiculer des marqueurs de véridicité historique tout en présentant une vérité fictionnelle seulement vraie à l’intérieur de la fiction » (p. 67). En revanche, dans une œuvre d’Adel Abdessemed comme Décor (2012), constituée de quatre Christ à échelle réelle en fil de fer barbelé rasoir — référant au camp de Guantanamo —, présentée au musée Unterlinden de Colmar en confrontation avec le Christ en croix de Grünewald, la confusion est totale, selon Lageira. « L’Histoire passée et présente est vidée de sa signification, puisque tout est dans tout », dans Décor. « À force de tout placer sur le même plan », juge Lageira, « on obtempère à ce dangereux projet de gommer les significations précises de tels événements pour mieux dévoyer la véridicité historique » (p. 254).
Lageira prône ainsi de plus en plus clairement dans ce livre un entrelacement sans indiscernabilité des visées référentielle et fictionnelle pour les œuvres utilisant des documents et des archives qu’ils appellent « œuvres historisées ». Cet échange incessant entre les deux visées mises en tension forme une « dialectique des poétiques ». Le créateur, tout autant que le récepteur de l’œuvre, doit pouvoir identifier ce qui part en direction d’une visée fictionnelle et ce qui part en direction d’une visée « véritative ». Ils opèrent ainsi à la fois une identification artistique et une identification historiographique. Le terme latin historia signifie d’ailleurs « enquête », est-il bien sûr rappelé dans l’ouvrage. On pourrait ajouter, pour compléter les propos de Lageira, que cette démarche enquêtrice que le spectateur est incité à adopter est souvent stimulée par le doute. De nombreuses œuvres historisées instillent des marqueurs de doute — pour ainsi dire — qui invitent le spectateur à quitter son état de crédulité et de consentement passif. La suspicion est alors ce qui fait sortir de l’irréalité de l’univers fictionnel dans lequel le spectateur est plongé ou, à l’inverse, ce qui le fait sortir de la prétendue objectivité du point de vue documentaire pour regagner la relativité du regard subjectif porté sur la réalité.
Pour construire une théorie de l’art capable d’affronter ce problème de la référentialité et conjurer l’anti-réalisme des pensées simulationnistes, Lageira prend plus particulièrement appui, au sein du courant analytique, sur la pensée de John Searle et sur les textes les plus tardifs d’Hilary Putnam. Cet axe philosophique permet de penser clairement une distinction entre la représentation d’une part, et l’être auquel la représentation réfère d’autre part. « Les preuves en images et par images, dans une théorie réaliste de la référence », écrit Lageira, « se fondent sur cette distinction que nous avons affaire dans l’image à une représentation (un analogon) et que l’être auquel il est fait référence n’est pas une simulation, un simulacre, un autre analogon, mais une personne non reproductible en plusieurs exemplaires » (p. 180). L’image comme preuve a ainsi d’emblée un double statut : fictionnel en tant qu’analogon et référentiel en tant qu’indice. Par ailleurs, Lageira s’appuie fortement sur la position philosophique de Putnam selon laquelle il faut conjointement discréditer la dichotomie entre faits et valeurs (contre le positivisme logique notamment) et défendre l’objectivité de certaines opinions éthiques (contre le relativisme subjectiviste de Richard Rorty notamment). Selon cette orientation philosophique pragmatiste prise par Lageira, tous les jugements ontologiques reposent sur des valeurs morales. Cela revient à considérer que c’est lorsqu’un intérêt pratique est associé à une chose (jugement moral) qu’il devient intéressant de savoir si la chose existe ou non, et comment (jugement ontologique). Ainsi, selon cette conception, les faits et les valeurs ne peuvent être séparés. Tout jugement ontologique — ou factuel — suppose un jugement moral. Ou encore, tout questionnement sur l’existence de la chose a un préalable, qui est une évaluation de la valeur de cette chose. Se demander si un événement représenté existe réellement ou non, c’est toujours également engager un jugement moral à son égard.
Conséquemment, dans le champ de l’art, si une œuvre composée de documents historiques ne suscite aucune démarche enquêtrice chez le spectateur — au sens restreint d’un questionnement sur le statut des matériaux issus d’archives —, du même coup, elle coupe court à toute lecture critique, à tout jugement moral, puisque ce dernier accompagne et même précède le jugement ontologique. Lorsque le questionnement ontologique disparaît, la question éthique s’évanouit elle aussi. C’est pourquoi Lageira condamne les œuvres historisées qui ne contiennent aucune dimension référentialiste. Selon un premier cas de figure, ces œuvres désarticulent jugement ontologique et jugement moral au profit d’une prévalence accordée au jugement moral et subjectif, et basculent alors dans le relativisme éthique. Cette tendance serait le pendant artistique de la position philosophique de Rorty. Dans le second cas de figure, les œuvres n’incitent ni au questionnement ontologique, ni au questionnement évaluatif, mais uniquement à des jugements formels. Ce pur formalisme délesté de toute appréciation morale correspondrait alors à la position du positivisme logique en philosophie ou à toute forme d’amoralisme. Ainsi, c’est en faisant place à un horizon référentiel dans une œuvre hybridant fiction et document que, fort heureusement, un artiste peut contrer la promotion d’une neutralité axiologique. Et il opte alors, le plus souvent sans le savoir, pour une théorie réaliste de la référence d’obédience pragmatiste.
Enfin, dans le dernier chapitre, Lageira pose les linéaments de l’esthétique cosmopolitique qu’il appelle de ses vœux. Dans un premier temps, il distingue à très bon escient une Histoire fragmentaire, celle qui est incapable de « produire les éléments qui la constituent », d’une Histoire fragmentée, qui dissémine un « trop-plein d’informations en vue de manipulations diverses ». C’est ce premier savoir, fragmentaire, correspondant à ce que Carlo Ginzburg a nommé la « micro-histoire », qui doit être développé, au détriment de l’Histoire fragmentée, qu’il s’agit de combattre. Comme l’écrit Lageira, il faut pouvoir « distinguer la micro-histoire fragmentaire, aux trous et manques irréversibles dus à des éléments perdus involontairement au fil du temps, et la micro-histoire fragmentée, fabriquée en vue de ne pouvoir jamais être reconstituée » (p. 259). Cette dernière fragmentation, qui vise la dispersion — et non le recollement —, sert un capitalisme globalisé de plus en plus privatisé qui a besoin de brouiller notre vue sur l’Histoire pour mieux imposer son homogénéisation réductrice. Pour lutter contre cette fragmentation néfaste, la perspective offerte par Lévi-Stauss dans Race et histoire constitue une piste intéressante. Une civilisation mondiale ne peut se construire que si « la coexistence de cultures offrant entre elles le maximum de diversité » est assurée, écrit l’anthropologue. Aussi faudrait-il préserver les diversités culturelles et avoir un projet commun, celui de s’en remettre à des valeurs universelles. Dans le sillage du projet habermassien et de la Nouvelle Théorie Critique, mis en résonance avec le projet lévi-straussien, Lageira en appelle à un cosmopolitisme émancipateur, ni universaliste ni relativiste. « Tandis que l’universalisme, le relativisme et le nationalisme reposent sur un principe d’alternative exclusive (ou bien — ou bien), le cosmopolitisme repose sur le principe de l’inclusion additive (et — et) » écrit Ulrich Beck dans Qu’est-ce que le cosmopolitisme ? Ainsi, selon Lageira, l’humaine diversité n’exclut pas la commune humanité. Au contraire, les deux doivent s’inclure mutuellement. Pour ce faire, il est nécessaire de réhabiliter un certain criticisme kantien et en particulier l’idée d’une universalisation possible des jugements esthétiques. Non pas au sens où tout le monde devrait avoir le même jugement — ce serait l’option universaliste des discours dominants sur la mondialisation des arts —, mais au sens où les jugements peuvent être différents tout en ayant une prétention à l’universalité d’égale valeur. Il s’agirait d’une inclusion additive, comme celle souhaitée par Beck. Développer « une imagination dialogique de l’Autre internalisé », selon les termes de Lageira, deviendrait alors la motivation d’un artiste cosmopolitique.
Si, comme le veut Beck, « le critère de qualité du nouveau cosmopolitisme est l’autocritique idéologique », alors effectivement, comme l’écrit Lageira, « la démarche criticiste est justifiée et légitime », et elle « relève surtout d’une approche réflexive permettant de ne pas se rendre aveugle à certains faits, états ou conditions » (p. 276). Cette approche autocritique fait ainsi droit à la diversité des cultures et à un projet commun universaliste, auquel aucune valeur définie ne serait attachée, bien sûr. Car c’est seulement le projet criticisme qui est à partager et qui constitue ce commun. C’est donc le processus d’évaluation des valeurs qui est à universaliser. Pour cela, il faut pouvoir tolérer la pluralité des façons de référer à la réalité, tout en les mettant à l’épreuve de leur plus ou moins grande capacité à faire vivre aujourd’hui, pour nous, certaines réalités factuelles — y compris, et surtout, les plus intolérables —, ainsi que les événements marquants, traumatiques ou enfouis de notre Histoire. Finalement, contrairement au réalisme spéculatif, le réalisme pragmatiste de la pensée de Lageira n’a-t-il pas le mérite de conserver un certain corrélationnisme ? Car il semble bien que nous n’ayons jamais accès à la réalité, comme de nombreuses œuvres convoquées dans ce livre le font sentir. Nous ne cessons de construire une réalité à l’existence de laquelle nous croyons, mais que nous savons inatteignable. Aussi, contre l’arrogance et l’autoritarisme d’un réalisme spéculatif considérant qu’une voie rationnelle — déracinant toute propension à croire à un absolu — permet d’atteindre la réalité, n’est-ce pas la tolérance et la vigilance d’un réalisme esthétique pragmatiste et criticiste — optant, quant à lui, pour l’évaluation critique immanente des diverses façons de référer à la réalité — qui seraient à choisir en vue de la constitution d’une communauté esthétique émancipatrice ?
Dans L’Art comme Histoire, Lageira poursuit pour une part sa critique des postures théoriques et artistiques fictionnalisantes qui forment des nébulosités associatives hasardeuses, souvent négatrices ou dénégatrices des événements passés et, pour une autre part, l’auteur s’engage dans l’élaboration d’une esthétique cosmopolitique à même de constituer l’horizon vers lequel pourraient tendre les pratiques artistiques engagées dans une prise en charge historienne, autrement dit, celles qui relèvent d’un « Art comme Histoire ». Fondée sur une certaine articulation des visées référentielle et fictionnelle présentes dans une œuvre, qui doivent s’entremêler sans se confondre, la poétique proposée par Lageira pose en même temps les bases d’une éthique de l’usage des documents et des archives dans le champ artistique.
« Même si l’entrelacement est très serré, on pourra toujours déceler le vrai et le faux, la fiction et la véridicité historique, tout en ayant à l’esprit, mais aussi littéralement devant soi lors de l’expérience esthétique, que cet objet est composé de ces moments, facettes ou formes inséparables qui constituent précisément son hétérologie esthétique, artistique et plastique, produisant une poétique déroutante, ambivalente, voire ambiguë, jouant aux frontières de l’indétermination, mais jamais au point de verser dans la complète indétermination. » (p. 39)
Au fil des nombreuses œuvres décrites et commentées dans ce livre, le jeu de miroitement des facettes, activant chez le spectateur une conscience tantôt imageante, tantôt réalisante, se fait plus concret, précis et dialectique, et invite à affûter toujours plus la sensibilité critique à ces œuvres qui nous livrent une lecture de notre Histoire.
Judith Michalet
Les Invasions barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art d’Éric Michaud
Peut-être le motif qui pousse un auteur à entreprendre une généalogie de son propre champ d’étude, en l’occurrence l’histoire de l’art, n’est-il autre, en définitive, que le plaisir qu’il y prend, cette généalogie fût-elle éminemment critique. Car, à l’inverse, une histoire de l’histoire de l’art (outre qu’un tel programme s’avère être souvent plus redondant que réflexif) produit certes chez celui qui l’écrit une certaine aise, mais assurément pas la délectation qu’il y a à exhumer quelque texte honteux de la discipline, et plus encore à donner à relire des passages non moins embarrassants d’ouvrages pourtant célèbres que l’on avait mis un soin plus ou moins conscient à oublier à l’instant même où on les lisait. Éric Michaud s’est ainsi plu à tout relire, et à tout rappeler.
Non sans quelque inquiétude cependant, dans la mesure où son essai vise à démontrer que l’histoire de l’art a participé d’une « racialisation » des représentations, voire avec une réelle préoccupation, tant il est vrai que cette interprétation des œuvres persiste aujourd’hui encore, quoique à plus bas bruit qu’autrefois. À propos de l’opposition entre « races germaniques » et « races latines », Michaud écrit par exemple que cette grille de lecture est devenue « un modèle si ordinaire qu’il en est presque devenu invisible dans la littérature artistique où il s’est activement disséminé jusqu’à nos jours » (p. 114). Par ces mots, l’auteur définit en réalité tout l’enjeu de son essai : mettre en évidence les moments de formation de ces visions et les voies par lesquelles elles se sont diffusées jusque dans l’art contemporain et les discours qui l’accompagnent. Autrement dit, Michaud entend produire une critique des mécanismes constitutifs de ce que les sociologues (et les historiens de l’art avec eux) ont décrit comme des habitus.
L’auteur décrit en effet l’analyse du goût et de la manière par le comte de Caylus d’après la notion d’habitus telle que Marcel Mauss et Pierre Bourdieu l’ont affinée et dotée d’une portée éminemment critique. C’est dans ce contexte aussi que Michaud oppose à Caylus Winckelmann. « À l’opposé de cet "esprit de modestie et de libre enquête" qui caractérisait le Recueil d’antiquités de Caylus, écrit-il, l’immense ambition de Winckelmann et sa revendication d’un esprit de système s’affirmaient d’emblée dans l’Histoire de l’art dans l’Antiquité » (p. 43-44). Une part non négligeable des deux premiers chapitres des Invasions barbares est ainsi consacrée au père de la discipline auquel revient donc aussi la paternité non seulement d’une systématisation de ses développements mais de la naturalisation de ses enchaînements.
Le véritable apport de cet ouvrage tient ainsi au fait qu’il met en lumière la confluence de l’entreprise de Winckelmann avec l’évolution plus générale des représentations ; par quoi son auteur excède nécessairement le champ de l’histoire de l’art. Dans une perspective qui tiendrait aussi bien d’Alexis de Tocqueville que d’Hannah Arendt, Michaud constate en effet que cette évolution est rendue possible et amplifiée par l’avènement de l’État-nation, et avec lui de la démocratie, conjonction qu’il situe à la fin du xviiie siècle. « La conséquence la plus remarquable et la plus dévastatrice de ce tournant, écrit-il, fut que le public, désormais potentiellement élargi à l’ensemble des citoyens constituant la "nation", n’était plus invité à comparer les qualités respectives de tableaux singuliers, mais à comparer les qualités supposées propres à chacune des écoles nationales, c’est-à-dire à dresser, dans et grâce à l’espace du musée, une cartographie des "caractères nationaux" d’autant plus faciles à déchiffrer qu’ils étaient présumés affleurer à la surface même des peintures. » (p. 49-50).
Selon Michaud, Winckelmann n’aurait donc fait lui-même que suivre une pente sur laquelle glissait avec lui le siècle tout entier avant que le suivant n’en recueille les préjugés fondamentaux et ne les considèrent comme essentiels ; essentialisation dont la perte du concept de perfectibilité constitue l’indice symptomatique. Il soutient en conséquence que, « sans même s’en rendre compte, [Winckelmann] réduisait ainsi à néant la théorie d’un beau idéal fondé sur un travail tout intellectuel de sélection et de condensation. La beauté idéale des Grecs était soudain devenue naturelle, tout comme était naturelle aussi l’extrême laideur des Kalmouks. » (p. 68) Et compte tenu de l’indiscutable fascination qu’exerça l’Histoire de l’art dans l’Antiquité, Michaud parle même de « syndrome de Winckelmann », lequel revient selon lui « à ne pas distinguer les figures de l’art de leurs modèles vivants » tout en se présentant comme « un véritable principe heuristique. » (p. 98)
Que cette conception de l’histoire de l’art repose sur un vice logique ou à tout le moins sur des faiblesses systématiques patentes (dont certains contemporains ne furent d’ailleurs pas dupes, comme le rappelle l’auteur) ne diminue en rien l’influence des théories de l’inventeur de l’histoire de l’art (Pour reprendre le titre de l’essai d’Édouard Pommier que Michaud ne mentionne étonnamment pas : Édouard Pommier, Winckelmann, inventeur de l’histoire de l’art, Paris, Gallimard, 2003). Michaud repère d’ailleurs un phénomène analogue dans le cas d’Aloïs Riegl. « On ne peut que rester perplexe, écrit-il, devant l’immense et durable succès de ses thèses lorsque l’on prend garde à l’extrême fragilité de quelques-uns des principes sur lesquels elles se fondaient. » (p. 136)
C’est qu’en réalité Michaud passe au crible toute une cohorte de grands noms et pointe chacune des compromissions de leurs productions intellectuelles. Pour le seul cas français, il rappelle notamment qu’Hippolyte Taine appelait à ce que les corps vivants prennent littéralement modèle sur les corps figurés de la Renaissance (p. 92-93), ou que Louis Courajod a opéré, à travers la notion de « survivance », la synthèse entre « race » et « style » (p. 133-134), synthèse qui a marqué de son empreinte aussi bien l’histoire de l’art « profane » d’Élie Faure (p. 96-97 et 189) que celle, universitaire, d’Henri Focillon (p. 139). En Allemagne, c’est à Heinrich Wölfflin qu’il appartient d’avoir forgé la notion de « style de race » (Rassenstil) (p. 53), thème devenu si courant qu’on le retrouve, mâtiné d’un antisémitisme lui-même travesti de philosémitisme, jusque dans des textes d’Herbert Read que celui-ci republie à la fin des années 1960 et, au début de la décennie suivante, dans ceux de Werner Haftmann (p. 171-172). Si, de l’intérieur de la discipline, Ernst Gombrich défit le mythe de l’innocence du regard, Michaud entend quant à lui démystifier celle de l’histoire de l’art elle-même, laquelle, sous couvert de petits discernements, joua un rôle pivot dans la constitution d’une épistémè hautement discriminatoire.
Cependant, lorsque l’auteur des Invasions barbares annonce qu’il pousse l’aiguillon jusqu’au seuil du contemporain, en ce que, avance-t-il, « bien loin de s’être émoussée après la Seconde Guerre mondiale, la conviction que l’art témoigne de la continuité d’un peuple ou d’une race s’est, on le verra, très largement recomposée grâce au long processus d’ethnicisation de l’art qui s’est engagé depuis les années 1950 » (p. 224), son épilogue laisse le lecteur quelque peu sur sa faim, comme si Michaud préparait en réalité de nouvelles recherches sur le sujet. Cette limite de l’essai n’invalide en aucun cas ses hypothèses, tant il est vrai qu’un certain discours sur l’art contemporain, qu’il s’agisse de le louer ou de le blâmer, n’en a pas fini avec cet héritage et trouve en lui les mêmes facilités critiques.
L’effet d’homogénéisation (ce qu’Arendt désigne sur le plan politique comme un processus de mise en cohérence du réel) de la « racialisation de l’histoire de l’art », que Michaud traite en son chapitre iii, a exercé une telle puissance explicative qu’il a durablement désorienté la recherche et induit le regard en erreur. Si un autre chantier encore devait être ouvert, il porterait alors aussi bien sur les discours que sur les pratiques artistiques, et il faudrait se demander en conséquence si des œuvres résultant de la circularité entre les sphères discursives et pragmatiques ne répondent pas à un tel régime de confusion à l’égard duquel elles apparaissent, en toute fin de compte, comme des prophéties auto-réalisatrices. À cela s’ajoute un facteur décisif quant à la persistance de telles grilles d’analyse aujourd’hui : l’intégration des œuvres et de leurs commentaires sur le marché de l’art, lequel ne saurait fonctionner, à tout le moins au niveau de ses acteurs primaires que sont les acquéreurs, sans motiver ou assortir la vente d’une explication légitimant lesdites acquisitions. Or, en l’espèce, l’efficacité de l’interprétation est inversement proportionnelle à son degré d’élaboration, et l’on devine pourquoi l’explicitation ethnique est tout particulièrement prisée, et qu’un monde dynamique au niveau des échanges s’accommode fort bien, voire tire profit, d’un univers relativement stable (pour ne pas dire conservateur ou réactionnaire) au plan de l’interprétation et des valeurs qui en découlent.
Un tel prolongement des thèses de Michaud serait néanmoins assez désespérant s’il ne portait en réalité sur un domaine - celui de l’art - en partie irréductible aux lois des mécanismes et des systèmes. Il serait d’ailleurs intéressant de se demander dans quelle mesure l’histoire de l’art, en prenant modèle sur les approches classificatoires et évolutionnistes des sciences de la vie, a aussi, en retour, « modélisé » ces dernières, pour le meilleur et pour le pire : soit en y instillant une dimension irrationnelle, voire pulsionnelle, soit en stimulant leur développement (on pense notamment aux recherches d’Horst Bredekamp sur ce second aspect). Un tel biais permettrait sans doute de proposer une autre cause à l’attrait qu’ont exercé les théories de Winckelmann, de Riegl, de Wölfflin, ou même de Courajod, sur leurs contemporains et au delà - à l’intérieur de la discipline comme à ses frontières.
La notion de « survivance », pour ne donner que cet exemple, n’est déjà plus la même chez Focillon, de même qu’elle diffère de celle, pourtant étymologiquement équivalente, d’« après-vie » (Nachleben) telle que l’a théorisée Aby Warburg. De même, on ne saurait rendre compte du fait que Walter Benjamin ait repris à Riegl la notion d’attention (Aufmerksamkeit), comme l’a soutenu Michael Gubser (Michael Gubser, « Time and History in Alois Riegl’s Theory of Perception », Journal of the History of Ideas, vol. 33, n° 3, juillet 2005, p. 451-474), sans reconduire pour autant le système interprétatif dans lequel l’auteur du Portrait de groupe hollandais l’avait inscrit si l’on ne saisissait que cette ponction est aussi une retraduction, c’est-à-dire, en l’occurrence, une subversion.
En d’autres termes, certains des défauts mêmes que pointe à juste titre Éric Michaud au cœur des systèmes de pensée de ces grands historiens de l’art ont eu une toute autre postérité pour la simple raison qu’ils ont été subvertis par leurs exégètes, c’est-à-dire repensés. La généalogie de l’histoire de l’art comme articulation d’une épistémè de la domination est certes jalonnée d’exceptions - d’éclats transgressifs -, mais ces exceptions elles-mêmes possèdent le plus souvent une filiation (pour ne pas dire ici une généalogie) qui n’est pas étrangère aux concepts dominants. Il en va d’ailleurs de même de ces œuvres qui semblent d’abord correspondre en tous points à une tradition (c’est-à-dire à une forme de mixte pratique-théorique dont la déclinaison contemporaine s’apparente à un habitus), mais dont en réalité un détail, une imperceptible transformation, force le cadre traditionnel et opère ainsi une sorte de petit coup d’état intérieur, ainsi que Jean Laude désignait les écarts à la règle « par lesquels un artiste, dans les sociétés les mieux policées, rompt avec les expressions canoniques et se distingue de l’artisan » (Jean Laude, La Peinture française et « l’art nègre » (1905-1914). Contribution à l’étude des sources du fauvisme et du cubisme [1968], Paris, Klinksieck, 2006, p. 25) ; comme le penseur, est-on tenté d’ajouter, se distingue de l’idéologue en subvertissant les idées qu’il entend mettre en œuvre.
Paul Bernard-Nouraud
Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels d'Aline CAILLET
Que ce soit à la télévision ou au cinéma, les documentaires nous sont désormais devenus familiers ; nous sommes capables par exemple de faire la part de fiction et de réalité qui les compose. Cette aisance est telle que des formes hybrides ont pu se développer, comme celle qui consiste pour les acteurs à moquer le genre sérieux du documentaire en se comportant comme s’ils étaient filmés pour un reportage en prise de vue directe ; c’est la veine surtout anglo-saxonne appelée « mockumentary ». Mais si familières qu’elles soient, ces catégories esthétiques de fiction et de réalité sont-elles vraiment faciles à démêler ?
Le travail d’Aline Caillet dans ce livre s’attache à interroger ces catégories pour en révéler le paradigme latent et généralement peu interrogé. La question qui l’intéresse à travers les films documentaires est le rapport effectif que la production filmique peut ambitionner d’entretenir avec le réel. Or, ce rapport s’est considérablement complexifié au cours des xxe et xxie siècle, puisque le film documentaire n’est plus — et n’a peut-être jamais été — un objet mêlant la prise de vue de la réalité à un discours didactique. Par exemple, le film Joli Mai de Chris Marker (1963) semble de facture classique, par sa belle image en noir et blanc et son discours presque romantique porté par le phrasé chantant d’Yves Montand en voix off. Néanmoins ce que « documente » le film au moyen d’enquêtes et de scènes de la vie quotidienne, les images le font moins comprendre que le commentaire lui-même. Le réel capturé relève de la fabrication car le sujet du film est une gageure : il s’agit de montrer l’ambiance à la fois détachée et grave de la vie parisienne au sortir de la guerre d’Algérie, un événement dont les personnes filmées ne parlent pas. Aline Caillet explique ainsi que les films de Marker en général procèdent d’une « déconstruction de la vision, de ce que signifie voir le réel » (p. 76) et ceci passe par le décalage irréductible entre image et discours.
La nouveauté qui motive plus précisément le travail de redéfinition conceptuelle mené par l’auteure est l’appropriation de plus en plus importante de la pratique documentaire par les artistes contemporains. La multiplication de leurs démarches riches et hétérodoxes a même donné au phénomène l’appellation de documentary turn, et justifie largement l’intérêt que lui porte Aline Caillet. « De fait, observe-t-elle, une théorie esthétique du documentaire, qui intègre les différentes traditions (cinéma, performance, arts visuels) et prenne acte des bouleversements formels que l’on observe depuis une bonne dizaine d’années, reste à écrire » (p. 12). Il s’agit donc de penser à nouveaux frais le rapport au réel qu’instruisent les différents médiums plastiques, et qui relance la question de ce qu’on appelle aujourd’hui un documentaire.
La réponse à cette question passe dans la première partie de l’ouvrage par l’exploration d’options théoriques exploitées par les artistes/documentaristes.
D’un côté on trouve les partisans du réalisme. Ceux-là entretiennent à l’égard du réel un rapport mimétique qui consiste à considérer que la réalité est extérieure au sujet qui en rend compte. Ce paradigme — plutôt traditionnel dans la fabrique du documentaire — se signale notamment par le rejet de la fiction, au profit d’une mise en image du réel, qu’il s’agit de représenter le plus fidèlement possible. Pour Aline Caillet « la fidélité au réel s’établit alors sur un principe, à la fois épistémologique et perceptif — et non pas esthétique — celui de l’exactitude de la relation d’imitation » (p. 25). Le problème alors rencontré par beaucoup de réalisateurs de prise de vue directe est que la technique (l’équipe de tournage, les instruments), parce qu’elle est remarquée par les sujets filmés, parasite nécessairement la pure capture du réel ; tandis qu’un film de fiction écrit par un auteur et servi par des acteurs bénéficie paradoxalement d’un effet de naturel. Par exemple, le film Entre les murs, réalisé par Laurent Cantet en 2008, et dont une photo du tournage est reproduite en couverture du livre, donne vite au spectateur un sentiment d’immersion dans l’espace confiné d’une salle de classe alors que cette réalité scolaire, en partie authentique, est contrôlée par l’artifice de la mise en scène. Les collégiens filmés en cours de français ont bien des réactions de collégiens mais ils n’en interprètent pas moins un rôle, dans la mesure où ils ont pris une part active à son écriture.
Ceci nous amène à l’autre option théorique mise en évidence par Aline Caillet, et qu’exprime bien cette l’idée de Jacques Rancière citée en exergue du chapitre 2 : « le réel doit être fictionné pour être pensé ». Il s’agit là de l’option performative. En effet, délaissant l’idée que le réel correspond nécessairement à ce qui est visible dans le monde, plusieurs réalisateurs gagent au contraire que le film documentaire produit la réalité qu’il informe. Il s’agit alors de signifier le réel, de « le fabriquer et non le reproduire, prendre acte qu’il n’est pas visible mais doit être rendu visible » (p. 35), fût-ce au moyen de la fiction.
On peut retenir comme exemple paradigmatique de cette perspective l’analyse du film Valse avec Bachir d’Ari Folman, qui figure au chapitre 3. Le parti pris du film pour rendre compte des massacres de Sabra et Chatila au Liban en 1982 est de s’appuyer sur les témoignages partiels de ceux qui y ont participé plutôt que sur les images d’archives, au moins aussi fragmentaires. Ainsi, le film fabriqué en images de synthèse met en scène la difficulté — commune au réalisateur et à son protagoniste en proie au refoulement — d’identifier une réalité en soi.
Parce que la qualité de réel qu’on attache à un produit documentaire ne repose plus finalement sur sa représentation impeccable mais sur l’effort créatif et technique qui le fait exister sous une forme à la fois artificielle et signifiante, Aline Caillet est fondée à élaborer une méthode d’analyse de son objet qui tient essentiellement à l’étude de ses effets. Cette méthode s’inscrit dans le courant pragmatiste en esthétique et présente l’avantage d’approcher les objets documentaires non pas par ce qu’ils sont mais par ce qu’ils font. Est ainsi évité l’écueil qui consiste à réduire la démarche toujours singulière de chaque artiste à une taxinomie bien souvent critiquable, aussi bien que les catégories qu’elle promeut : cinéma / littérature / art contemporain / télévision ; documentaire / fiction / docufiction / ; film / vidéo / reportage/ installation, etc.
On s’explique mieux alors pourquoi Aline Caillet titre son essai « Dispositifs critiques » il s’agit de désigner par là tout produit plastique (et pas seulement un film, à l’évidence) qui interroge les moyens de dire le réel sans le réduire à une captation. Malgré la vogue du terme, l’auteure choisit quand même le mot « dispositif » pour parler des ouvres documentaires. Elle s’en justifie en introduction, en faisant valoir que le dispositif est un terme qui désigne en esthétique non pas proprement un objet fini mais plutôt une stratégie, qui semble ici se signaler par sa probité, sa capacité de faire place au réel. Le dispositif se donne donc comme ce qui établit « sur le plan esthétique une unité performative, au sens où, d’une part, ce qu’il produit n’est pas dissociable de la manière dont il le produit, et d’autre part, ce qu’il produit n’existerait pas sans lui » (p. 18).
Plus descriptive, la deuxième partie invite le lecteur « au cour des dispositifs ».
C’est l’occasion d’approcher de plus près les démarches d’artistes jusque-là inclassables, et que la théorie esthétique développée permet maintenant d’apprécier à sa juste mesure. Par exemple, le jeu de Peter Watkins avec les codes du documentaire de télévision pour faire état d’une catastrophe nucléaire imaginaire (The War Game, 1965) ; le film anthropologique de Jean Rouch Moi, un noir (1971) sur les jeunes immigrés nigériens d’Abidjan qui assurent eux-mêmes la mise en scène, ou encore l’ouvre de Till Roeskens sur un quartier populaire de Marseille, dont le plan est reconstitué à partir du récit de ses derniers habitants avant sa modernisation urbanistique (Plan de situation #6 : Joliette, 2003-2006) ; les exemples de dispositifs se multiplient au fil des chapitres. Mais si les pratiques décrites peuvent donner un effet d’éclatement des approches documentaires, les analyses d’Aline Caillet, toujours fines et minutieusement documentées, en font apparaître la cohérence ainsi que la pertinence. C’est ainsi qu’à la lecture de Dispositifs Critiques on prend la mesure de la teneur véritablement politique des pratiques artistiques documentaires, notamment contemporaines. Non pas parce qu’elles manifesteraient un engagement militant pour une cause, que l’on serait insidieusement invité à rallier, mais parce qu’elles sont des initiatives dé-hiérarchisées, qui mettent les occupants des territoires dans lesquelles elles s’implantent au centre de leur action : il s’agirait alors d’une forme de « politique latérale », suivant une formule commentée p. 127.
La relation de compréhension nécessairement médiate que la documentation des formes de vie d’autrui met en place auprès du spectateur se donne donc essentiellement pour tâche (politique) d’amener ce dernier à un état de conscience augmentée. Politique est donc aussi la démarche — renouvelée à chaque ouvrage — qui consiste pour Aline Caillet à mieux les faire connaître à ses lecteurs.
Benjamin Riado
Expérience esthétique et art contemporain de Marianne MASSIN
Alors que l’esthétique ne semble plus apte à rendre compte des pratiques artistiques contemporaines, Marianne Massin invite le lecteur à reconsidérer ce prétendu état de fait.
La première préconception stigmatisée réside dans l’unité de l’art contemporain : même s’il est vrai que certaines œuvres gagnent à être étudiée avec une approche philosophique non esthétique, il ne faut pas non plus ignorer toutes celles qui mettent en jeu un panel de perceptions et de sensations propre à l’expérience esthétique. L’auteure rappelle à ce sujet que l’esthétique ne se contente pas d’étudier le beau. Voilà une autre préconception levée. Ancrée dans son étymologie, l’esthétique renvoie en effet à l’acte de percevoir et de sentir avant de porter sur le beau. Il se trouve que, historiquement, au xviiie siècle où l’esthétique devient une discipline, le beau était un cas paradigmatique de cet acte. C’est ainsi dans le prolongement de la tradition kantienne que M. Massin décrit l’expérience esthétique comme une expérience fondamentalement réfléchie, une expérience pendant laquelle le sujet a accès à son acte de percevoir et de sentir, une expérience pendant laquelle le sujet s’éprouve lui-même. Cette position apparaît déjà dans la première partie de l’ouvrage, qui dresse un état de l’expérience esthétique, mais c’est dans la troisième partie que l’auteure déploie toute la force d’une description réfléchie de l’expérience esthétique. Nous comprenons très bien les raisons de cette première ébauche : la méthode n’a de pertinence qu’en fonction d’un objet, et la deuxième partie brosse une cartographie de l’art contemporain particulièrement en attente d’une approche esthétique. Autrement dit, l’objet premièrement défini par la méthode aiguise et précise en retour cette dernière.
Empruntant aussi bien au pragmatisme qu’à la phénoménologie, M. Massin ne présente pas une doctrine, mais œuvre réellement à la compréhension de l’expérience esthétique devant certaines pratiques d’art contemporain. Les réalisations de A.V. Janssens, de V. Burgin ou de C. Parmiggiani occupent une place privilégiée, et pour cause, leurs créations proposent au spectateur un univers déstabilisant les habitudes perceptives. Toutefois, il ne s’agit pas d’écrire sur la seule illusion d’optique, l’ouvrage explicite bien que si les habitudes perceptives sont déstabilisées, c’est par rapport à une attente. La culture, en général, et l’histoire de l’art, en particulier, génèrent des attentes et sont donc à considérer dans l’expérience esthétique. C’est de la sorte que M. Massin parvient à proposer une description de l’expérience esthétique qui considère l’histoire de l’art et qui fonctionne comme philosophie de l’art. En ce sens, si l’expérience esthétique présentée dans cet ouvrage parvient à rendre compte des pratiques contemporaines, c’est aussi parce qu’elle se veut résolument intempestive. Il faut dire que l’expérience esthétique est en elle-même éminemment intempestive au sens où elle peut advenir à contre-temps. L’exemple de la déstabilisation des attentes le montre bien. M. Massin approfondit d’ailleurs ce point en référence à H.R. Jauss autour de la notion de déception. Elle met ainsi en avant la temporalité et le dynamisme propres à l’expérience esthétique en insistant parallèlement sur les stratégies plastiques mises en jeu par les artistes pour susciter et préparer cette déception. Bien entendu, de la même manière que le déplaisir du sublime kantien, ou du ravissement, engendre un plaisir, cette déception devient les fondations d’un plaisir esthétique. L’auteure précise justement qu’une « telle expérience est négative par la visée déçue, mais peut prendre un caractère fructueux par un retournement où l’on expérimente ses attentes et où l’on s’éprouve ainsi soi-même » (p. 105). Autrement dit, la déception est programmatique. On pourrait à ce sujet peut-être regretter que l’étude de ce comportement ne soit pas accompagné d’un travail sur le priming – ou effet d’amorçage – afin d’identifier plus distinctement les relations entre les propositions artistiques, la déception alors impulsée et l’acte réfléchi qui est au fondement de la pensée de M. Massin. Il s’agit toutefois d’un choix disciplinaire fort : cet ouvrage propose un abord des problèmes de l’expérience esthétique à partir du champ de l’esthétique. Ainsi, au lieu d’emprunter à la psychologie de la perception pour étudier la déception sous un autre angle, l’auteure préfère s’attaquer aux liens entre propositions artistiques et acte réfléchi par la quête de signification du spectateur. C’est plus précisément la notion de signifiance qui est ici centrale. Posée notamment par É. Benveniste et R. Barthes, la signifiance se distingue de la signification en ce que cette première met l’accent non pas sur le sens de ce qui est véhiculé, mais sur la capacité à avoir un sens, un sens qui ne soit pas nécessairement défini. M. Massin insiste sur l’entremêlement entre « sensorialité et quête de signifiance » (p. 141). Peut-être parce qu’elle n’aboutit jamais, la quête de signifiance semble apte à permettre le retour réfléchi sur soi caractéristique de l’expérience esthétique.
Marianne Massin, dans Expérience esthétique et art contemporain, propose une description de l’expérience esthétique qui, sans être strictement désintéressée au sens kantien, n’en est pas moins non privée. La communicabilité occupe une place importante, même lorsque sont analysées des œuvres traitant d’intimité comme celles de N. Goldin ou de C. Boltanski. Même si l’on comprend très bien l’exemplarité des œuvres choisies, on aurait aimé confronter cette théorie esthétique devant des œuvres échappant davantage au champ de l’esthétique. Ce n’est peut-être pas le souhait de l’auteure, mais l’expérimentation de sa propre expérience pourrait éventuellement se retrouver dans de nombreuses œuvres parfois utilisées par certains pour exhiber la fin de l’esthétique. Aussi, en généralisant l’expérience esthétique au-delà du beau et du sublime et en insistant sur l’acte réfléchi, cet ouvrage marque un renouveau de l’expérience esthétique.
Bruno Trentini
Planètes Sonores — Radiophonie-Arts-Cinéma, nouvelle édition revue et augmentée d’Alexandre CASTANT
Planètes Sonores est un voyage à travers les divers champs de créativité développés tout au long du XXe siècle à la charnière entre l’audible et le visible, explorant le dense réseau des relations — des correspondances mais aussi des écarts et des conflits — qui se tissent entre l’œil qui écoute et l’oreille qui voit.
Des travaux d’Abraham Moles et de Pierre Schaeffer aux films d’auteur et des avant-gardes historiques à l’art contemporain et à la vidéo, Alexandre Castant propose un panorama transdisciplinaire et documenté de l’expérimentation sur les phénomènes sonores dans le but d’en dégager la poétique propre ainsi que les modalités de leur inscription dans le cadre plus large de questions esthétiques touchant à la temporalité, l’immatérialité et la présence de l’œuvre d’art.
Le livre est structuré autour de trois grands axes déterminés respectivement par la création radiophonique, les arts plastiques et le cinéma.
Dans un premier temps l’insistance sur le caractère technique de la conquête du son par la modernité permet d’élargir la problématique au-delà du phénomène musical et d’établir un parallèle entre la photographie et l’enregistrement sonore tout en liant l’expérimentation artistique avec les recherches scientifiques en acoustique et l’histoire de la radiophonie française.
Les nouvelles possibilités expressives offertes par l’autonomisation du son comme élément plastique sont au centre d’un questionnement sur la spatialité, la figurabilité et la sémantique de l’image sonore qui développe ses ramifications à travers l’analyse d’œuvres de Kurt Schwitters, Robert Rauschenberg, John Cage, Joseph Beuys, Christian Marclay et Sarkis, entre autres artistes.
Si la recherche de musicalité était inhérente à l’abstraction picturale moderniste et aux aspirations avant-gardistes à la réunification des sphères séparées de la sensibilité, dans l’art contemporain elle apparaît comme vecteur d’hybridation d’un ensemble de pratiques et de médias qui questionnent les limites d’une expérience sensible par définition fragmentaire et discontinue, située dans l’écart entre le devenir-image du son et la part sonore de l’image.
Le cinéma occupe une place centrale dans cette exploration de l’esthétique du son à travers l’étude de films d’Alain Robbe-Grillet, Jean-Luc Godard, Brian de Palma, Michelangelo Antonioni et d’autres cinéastes qui mettent en scène cette « fusion de la déchirure » que constitue pour Gilles Deleuze l’image audiovisuelle.
Musique, voix, bruit, infra-basses et ultra-sons, Planètes Sonores cartographie la diversité des rencontres du son avec les arts visuels à travers une approche qui met les ressources de l’histoire et de la théorie de l’art au service d’une réflexion sur la création vivante.
Vangelis Athanassopoulos
L’expérience esthétique — Intuition et expertise de Dominique CHATEAU
L’expérience esthétique de Dominique Chateau est une réflexion philosophique qui invite à goûter des vins, des mets, des couleurs ou des sons avec l’attention du savoir. Sans doute, aucun discours ne saurait en la matière se substituer à l’expérience. Mais l’auteur engage son lecteur à dépasser le clivage traditionnel entre sensibilité et cognition qui tendraient à reléguer l’Esthétique au rang des sciences trop humaines pour être exactes.
D. Chateau ne réduit pas l’expérience esthétique à une intuition naïve, et nous rappelle les sédiments laissés à l’esprit qui déterminent le goût, individuellement et collectivement. « Faire une expérience » suppose qu’on « a » de l’expérience. Il y a ainsi dans l’esthétique « une certaine part d’objectivité d’autant plus efficace qu’elle est enfouie ».
Dépassant le dualisme du sujet et de l’objet, l’auteur n’a pas cherché à dissimuler son goût dans l’espoir d’une apparence d’objectivité, et donne, entre un commentaire de Hume et un de Kant, des conseils de dégustation de vin. Au fil des pages on suit une voie où la subjectivité du goût n’est pas exclusive de l’expertise, une voie « aussi peu rectiligne que possible ». Pourtant, loin de toute apologie du subjectivisme, une telle attitude ouvre sur une réflexion à la fois sociologique et pédagogique, posant la question des conditions culturelles de l’expertise et la possibilité de sa transmission dans la société.
Mais alors, sur quelle norme faire reposer l’expertise lorsque celle-ci est teintée du relativisme qu’implique les déterminations individuelles ? C’est pour répondre à cette question que l’auteur propose ici un complément à la théorie humienne.
Tout en rendant compte de son expérience, D. Chateau théorise l’écart qui distingue le moment intuitif où il a éprouvé l’objet, de l’expertise qui en liste les qualités. Il analyse ainsi le chemin qui mène de la contemplation à la confrontation des verdicts. Or l’auteur nous fait remarquer combien chacun de ces moments intéressent particulièrement des traditions philosophiques habituellement opposées, et qu’il nous invite à concilier au bénéfice de notre propre expérience.